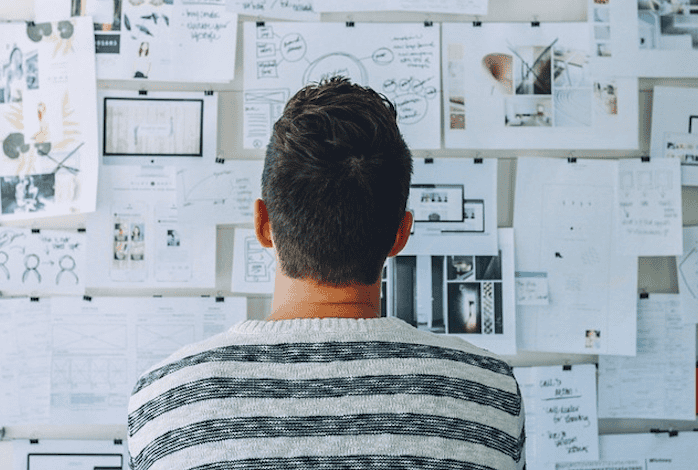Les jeunes en arrêt maladie : des chiffres révélateurs
La semaine dernière, j’entendais à la radio que les jeunes de moins de 30 ans se mettent plus souvent en arrêt maladie que les autres.
Plus précisément, près d’1 jeune actif sur 2 (49 %) de 18 à 30 ans a eu un arrêt maladie en 2024. C’est 7 points de plus que l’ensemble de la population. C’est presque le double des salariés de plus de 60 ans. Ces chiffres sont tirés du 9e baromètre Malakoff Humanis – Ifop, un échantillon représentatif composé de 400 dirigeants d’entreprise et 3 000 salariés du secteur privé, interrogés entre le 6 et le 30 janvier 2025.
Santé mentale : des besoins encore trop invisibilisés
Les principales causes de ces arrêts sont d’abord les maladies ordinaires, comme la grippe, puis l’épuisement professionnel et les troubles psychiques. Et je me demande : si les troubles psy étaient mieux connus et reconnus, ne seraient-ils pas en première place ? Probablement.
J’ai aussi lu que les jeunes sont “en meilleure santé” que les autres. Mais selon quels critères ? Quelle définition de la santé a été retenue ici ? Selon l’OMS, la santé ne se résume pas à l’absence de maladie, mais désigne un état de complet bien-être physique, mental et social. Les chiffres de ces dernières années montrent bien que nombreux sont les jeunes qui souffrent.
“Tenir bon” : un modèle qui fragilise
Sans dire qu’ils souffrent plus que les autres, les jeunes se mettent plus en arrêt. Et que peut-on en conclure ? Qu’ils se protègent davantage. Et ça… c’est mal vu.
Même s’il existe un discours ambiant, notamment sur les réseaux sociaux (mais c’est peut-être aussi parce que je suis beaucoup de comptes de psys, donc je suis biaisée) qui dit : “prendre soin de sa santé n’est pas une faiblesse”, dans la réalité, il est encore très (trop, à mon goût) valorisé de “serrer les dents”, de “tenir bon”, quitte à mettre sa santé en jeu.
Ce qui prime encore trop souvent, c’est le fait de tenir, de ne pas craquer, de rester productif.
Une génération marquée par les crises
La pandémie, même si elle a parfois bon dos, est survenue à un moment crucial dans le développement de cette génération. Isolement, disparition de la vie sociale réelle, retour forcé dans le foyer familial (et on sait que ça peut très mal se passer)… Les raisons sont nombreuses pour expliquer à quel point cette période a pu marquer les jeunes psychiquement. Ajoutons à cela la catastrophe climatique, les guerres, l’actualité internationale anxiogène… et on comprend que le terrain est fertile à l’inquiétude.
Le monde du travail, aujourd’hui, n’est pas tendre. Pour personne. Mais les jeunes qui y entrent doivent souvent courber un peu plus l’échine : premier emploi, précarité, nécessité de faire ses preuves, de valider une période d’essai… Autant d’éléments qui rendent plus difficile le fait de poser ses limites. Et certains en profitent. Ce qui peut générer des tensions, y compris managériales.
Le monde du travail : un terrain difficile pour les jeunes
Sans parler des petites remarques à connotation “âgiste”, du type : “ah bon, tu sais faire ça, à ton âge ?”. Même lorsqu’un·e jeune est formé·e, qu’il ou elle a déjà une expérience (au moins par les stages), il ou elle peut être considéré·e comme moins compétent·e, simplement parce qu’il ou elle est jeune. Ces remarques sont souvent le reflet d’un étonnement face à leurs compétences. Et cet étonnement dit quelque chose.
On parle peu de l’âgisme, et pourtant il est partout. Et il ne concerne pas que les personnes âgées. L’âgisme, c’est la discrimination fondée sur l’âge, dans un sens ou dans l’autre. Plus précisément, dans son article fondateur, Butler (1969) définit l’âgisme comme « un processus de stéréotypage et de discrimination systématique contre des personnes parce qu’elles sont âgées », mais depuis, la littérature a élargi cette notion à l’ensemble du spectre générationnel. Donc contrairement à ce qu’on pense souvent, l’âgisme ne touche pas que les personnes âgées : il peut aussi frapper les plus jeunes, en particulier dans le monde du travail. Les jeunes peuvent être touchés par l’âgisme, avec cette idée qu’ils sont fainéants, sans sens de la hiérarchie, peu compétents. Et cette forme d’âgisme, encore peu reconnue, peut avoir des conséquences concrètes : moindres responsabilités, infantilisation, invisibilisation de leur mal-être, ou surcharge “à titre d’apprentissage”.
En 2021, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié son premier rapport mondial sur l’âgisme. Une reconnaissance officielle de l’impact profond et négatif que peuvent avoir les discriminations liées à l’âge sur la qualité de vie, le bien-être, la santé et même l’espérance de vie.
Quand les stéréotypes deviennent performatifs
Aussi, grâce à la psychologie sociale, on sait que les personnes ciblées par un stéréotype ont tendance à adopter le comportement qui y correspond – on parle de menace du stéréotype. Cela n’est pas choisi, c’est inconscient : on sait ce qui est attendu de nous, il y a une pression implicite, on est fragilisés. En disant des jeunes qu’ils sont paresseux, peu fiables, démotivés, on augmente la probabilité qu’ils adoptent ce comportement. Cela s’appelle la menace du stéréotype (Steele & Aronson, 1995). Il y a aussi l’effet d’étiquetage : lorsqu’on dit d’une personne qu’elle est ceci ou cela – fiable, souriante, fainéante, elle aura tendance à vouloir correspondre à cette étiquette. On crée donc le problème que l’on prétend dénoncer.
Que faire quand on est jeune et en difficulté au travail ?
Tout dépend du contexte, bien sûr, et de comment vous vous sentez. Parlez de votre situation à votre manager, à votre N+2, à vos collègues, aux représentant·es du personnel, à la médecine du travail, aux responsables RH. C’est aussi à l’employeur de veiller à votre santé, de réguler la charge de travail, de réduire les tensions, de clarifier les tâches, d’assurer votre intégration… E si vous en ressentez le besoin, mettez-vous en arrêt.
Puis, si rien ne change : envisagez un départ. Pas sur un coup de tête, bien sûr. Dans l’idéal, cela doit être fait en conscience et avec un plan. Mais ne restez pas dans un environnement qui crée chez vous un mal-être.
Pour aller plus loin concernant l’âgisme et la menace du stéréotype :
- Butler, R. N. (1969). Ageism: Another form of bigotry. The Gerontologist, 9(4), 243-246.
- Steele, C. M., & Aronson, J. (1995). Stereotype threat and the intellectual test performance of African Americans.Journal of Personality and Social Psychology, 69(5) , 797–811. https://doi.org/10.1037/0022-3514.69.5.797